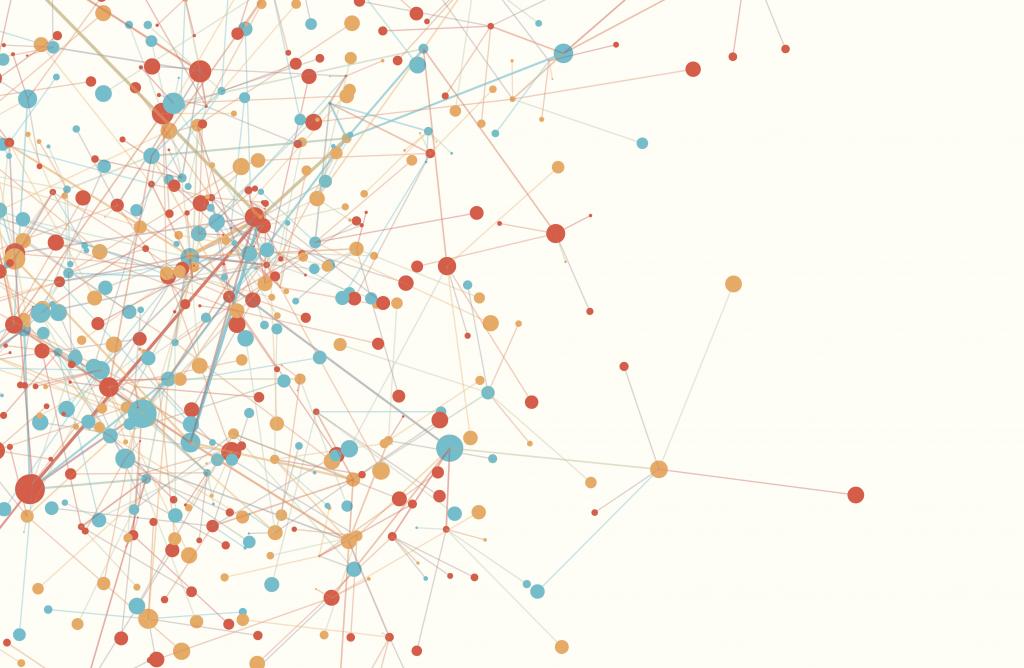En adoptant la mobilité comme clé de lecture, Alessandro Monsutti offre dans son dernier livre (PUF, septembre 2018) une perspective décentrée sur le monde contemporain à travers une ethnographie globale de l’Afghanistan. C’est l’Homo itinerans dans toutes ses nuances qui en est l’objet, son observation prenant en compte autant le déplacement des réfugiés provenant d’Afghanistan que la circulation des experts qui se rendent dans ce pays pour participer à l’effort de reconstruction post-conflit. Rencontre avec l’auteur.
Pourquoi ce choix d’observer les Afghans dans leur déplacement, plus que dans leurs montagnes? Et pourquoi faut-il parler des ONG pour comprendre la planète sur laquelle ils vivent?
Ce livre a une longue généalogie née de mon envie – il y a de cela longtemps – d’écrire un livre d’anthropologie politique sur la reconstruction de l’Afghanistan, notamment à partir d’un projet de réhabilitation rurale financé par la Banque mondiale, le National Solidarity Program. Mais au fil de mon travail, j’ai constaté qu’il était difficile de m’en tenir à cet objectif, car je disposais de beaucoup de matériel empirique recueilli lors de mes pérégrinations en Australie et en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Canada, en Europe, et non seulement en Afghanistan, au Pakistan et en Iran. Pourquoi, pour autant, la mobilité? Dès mes premières recherches de terrain, je me suis intéressé aux réfugiés; il aurait été fallacieux de prétendre étudier les paysans chez eux alors que l’on se trouvait dans un contexte de conflit et de déplacement forcé. Mais de façon plus profonde, j’ai toujours considéré que la mobilité était un aspect constitutif de la vie sociale et un point d’entrée pour questionner les catégories centrées sur la triade État-population-territoire. Beaucoup d’Afghans que je rencontrais avaient combattu dans leur pays d’origine mais aussi travaillé à l’étranger; leur réalité sociale, même avant l’invasion soviétique et l’exode d’une partie importante de la population, était marquée par une circulation permanente. Autrement dit, pour comprendre les dynamiques sociales d’un village du centre de l’Afghanistan, il faut passer du temps à Melbourne, où certaines personnes qui ont réussi à s’y établir réunissent de l’argent qu’elles envoient aux familles restées sur place. Pour comprendre l’arène politique afghane, il est réducteur de se limiter au territoire national, pas plus qu’il ne faut se limiter aux seuls acteurs afghans. Cette arène est définie par d’autres personnes mobiles et par les institutions internationales et non gouvernementales qui les emploient. La vie et les modes de sociabilité des militaires présents sur place m’ont par exemple également intéressé. Un chapitre part d’ailleurs d’une soirée passée avec le numéro deux des forces armées américaines en Afghanistan. Il y a aussi des récits contant des discussions avec de jeunes soldats avouant être sortis des États-Unis pour la première fois pour se retrouver dans une caserne au bout du monde, effrayés par le cadre inhabituel qu’ils découvraient.
Ce livre est une succession d’histoires de gens qui circulent, partant du principe que nous sommes tous en itinérance, mais chacun à sa manière. La forme prise par cette mobilité nous apprend beaucoup. Le soldat américain de l’Iowa, l’officier supérieur sorti de West Point, le responsable des élections locales, les cadres d’un ministère qui suivent une formation organisée par notre Institut à Abu Dhabi, tous ces gens expriment à leurs échelles les multiples facettes d’une réalité politique et sociale à la fois locale et globale. Je les ai donc pris autant comme des vecteurs pour comprendre les réalités de l’Afghanistan, ce pays étant presque un prétexte, que comme des portes d’entrée dans une arène globale où les différentes manières d’être mobile nous racontent les relations inégales de pouvoir. Car je suis fortement attaché à l’idée que l’histoire humaine est faite de déplacements, de mobilités multiples et croisées.
Ce regard a-t-il dévoilé des réponses inattendues?
Le principal enseignement de ce cheminement, au fond, est de douter. De larges segments de la population afghane ne sont pas convaincus par les mérites des programmes de promotion de la démocratie, des droits de l’homme et de l’émancipation des femmes portés par les organisations internationales et non gouvernementales. Doutons de nos certitudes et soyons humbles envers les Afghans, qui sont eux aussi capables d’inventer des solutions, sans dépendre du prêt-à-porter du peacebuilding promu par la communauté internationale. Le livre se termine d’ailleurs par cette phrase: «Ce livre porte par là même un message de scepticisme face à toute prétention de leur [les Afghans] enseigner ce que signifie vivre ensemble.» Quand j’ai enseigné à Yale, une fille très sûre d’elle est venue vers moi, m’expliquant qu’elle avait passé six mois en tant que stagiaire à l’Afghanistan Desk du Département d’État à Washington. Elle se demandait si elle allait apprendre quelque chose dans mon cours. Je lui ai répondu que cela faisait dix-huit ans que je travaillais sur l’Afghanistan et que ce que je voulais partager avec les étudiants, c’était justement des questionnements critiques. Je lui ai donc proposé de venir partager les siens. Mais bon, elle n’est pas revenue. Elle ne lira probablement pas mon livre, qui est une invitation, en plus du doute, à l’écoute et au voyage. Ces destins croisés nous font comprendre que l’histoire récente de l’Afghanistan peut être interprétée comme l’échec du projet hégémonique de la paix et de la démocratie libérales, voire comme le reflet d’une lutte des classes d’un type nouveau, globalisée, dans laquelle je replace l’afflux récent de réfugiés en Europe.
Qu’apporte l’aspect littéraire, le récit de voyage, à la pensée anthropologique?
C’est une question très importante. L’écriture n’est pas qu’une mise à plat des résultats de l’enquête. C’est un réel moyen de production, de création. Ce n’est pas qu’un outil, c’est une méthode au sens épistémologique du terme, par laquelle on produit de la connaissance. J’ai fait ce choix méthodologique de commencer chaque chapitre par un moment vécu et où je prends la parole à la première personne du singulier. Il ne s’agit pas de fonder l’autorité de mon discours; le «je» me permet de situer mon regard. Je pars toujours d’un épisode apparemment anecdotique. Je raconte des scènes de vie observées parmi les villageois des montagnes afghanes ou au cours d’une soirée entre expatriés à Kaboul, j’évoque des lieux et des personnes, je brosse des atmosphères pour faire voir, entendre et sentir le quotidien des gens que j’ai rencontrés au cours de deux décennies de travail empirique. Certains portent un turban, d’autres une cravate; certains brandissent un lance-roquettes, d’autres un classeur rempli de récépissés… À partir de là, j’essaie de relier les fils et d’arriver à un niveau supérieur de généralité. C’est ça, l’ethnographie, c’est raconter des histoires simples de la vie quotidienne et montrer qu’elles contiennent des enseignements plus généraux sur la manière dont le monde d’aujourd’hui est gouverné. Sans toujours expliciter les références théoriques qui m’inspirent, je m’efforce de proposer à partir de ces petites vignettes ethnographiques des interprétations plus amples.
Aurait-il été possible de faire cet exercice sans l’utilisation du «je» et donc du «jeu»?
C’est une question redoutable. J’ai eu dans le passé un collègue qui travaillait sur le jeu d’échecs et s’intéressait au «jeu» comme phénomène sociologique. Il partait du constat que le jeu était l’une des rares pratiques parfaitement universelles. Toutes les sociétés humaines, passées, présentes et futures, jouent de toutes sortes de manières. Pour moi, l’écriture est un jeu, un jeu très sérieux, une mise en scène de soi et de l’autre. Le texte de Michel Leiris «De la littérature considérée comme une tauromachie» montre que l’écriture est une mise à nu, une prise de risque permanente, sur le modèle du torero qui descend dans l’arène. C’est ce que j’ai fait aussi en écrivant des choses parfois intimes pour situer comment mon positionnement orientait mon regard et la connaissance que je pouvais produire. L’émotion et la capacité d’évoquer les relations interpersonnelles deviennent ici des outils heuristiques. J’ai parfois raconté des anecdotes piquantes. Par exemple le jour de mon 30e anniversaire, je me suis retrouvé avec une kalachnikov sur le front. L’objectif n’est pas de me mettre en valeur par un récit picaresque, mais de montrer que si je suis arrivé à bon port, sain et sauf, ce n’est pas le cas de tous les itinérants dont j’ai croisé les destins. En définitive, en filigrane, j’ai voulu cartographier, au sens métaphorique, les inégalités globales.
Parmi les scènes de vie décrites, laquelle vous a le plus étonné, et pourquoi?
Il m’est difficile de répondre. Mais j’ai décidé d’ouvrir l’ouvrage par une rencontre qui, si elle a été fugace, m’a marqué. Je suis un jeune doctorant. On est au milieu des années 1990. Je traverse l’Afghanistan du Sud au Nord, seul. Un matin, après avoir dormi dans une auberge dans les montagnes de l’Hindou Kouch occidental, au centre du pays, je marche en compagnie d’un homme plutôt fanfaron qui, après avoir expliqué qu’il avait été grand commandant de la résistance face aux troupes soviétiques, se plaint des cailloux dans ses chaussures qui lui blessent les pieds. Je m’en sépare avec soulagement pour continuer seul en direction de Bamyan, la vallée des bouddhas. Le paysage est grandiose. J’avance au milieu des falaises rouges avec en ligne de fond les montagnes enneigées hautes de plus de 5000 mètres. Tout d’un coup, je vois un vieux monsieur accroupi sur un muret, avec un turban bleu signifiant qu’il avait effectué le pèlerinage chiite de Kerbela, en Irak. Après m’avoir invité à partager un morceau de pain et le thé tiède de son thermos, il propose de marcher en ma compagnie. Comme je lui demande d’où il vient, il me répond: «Je suis d’où je vais.» Je n’ai jamais oublié cette réponse. Voulait-il dire qu’il se rendait au prochain village d’où il était originaire? Ou bien, ce que je suppose, car même un paysan illettré est pétri de poésie mystique, s’agissait-il d’une référence soufie? Toute créature est destinée à retourner par des voies diverses vers son créateur. Nous ne sommes pas définis par le lieu où nous sommes nés mais par le chemin que nous parcourons. La vie en acte, la vie comme un voyage. On connaît l’origine, on connaît la fin, mais on ne connaît pas le parcours. Et c’est à chacun de faire de ce parcours quelque chose qui fait sens. L’Homo itinerans exprime la condition ontologique profonde de l’homme, une condition qu’il faut assumer face aux sédentarismes de tout bord que l’on voit réémerger aujourd’hui.
* * * * *
Citation de l’ouvrage:
Monsutti, Alessandro. Homo itinerans: la planète des Afghans. Paris: Presses Universitaires de France, 2018.
Interview par Marc Galvin, Bureau de la recherche.
Illustration: Carlo Vidoni, Chiocciola – tracce di esistenza (2015).